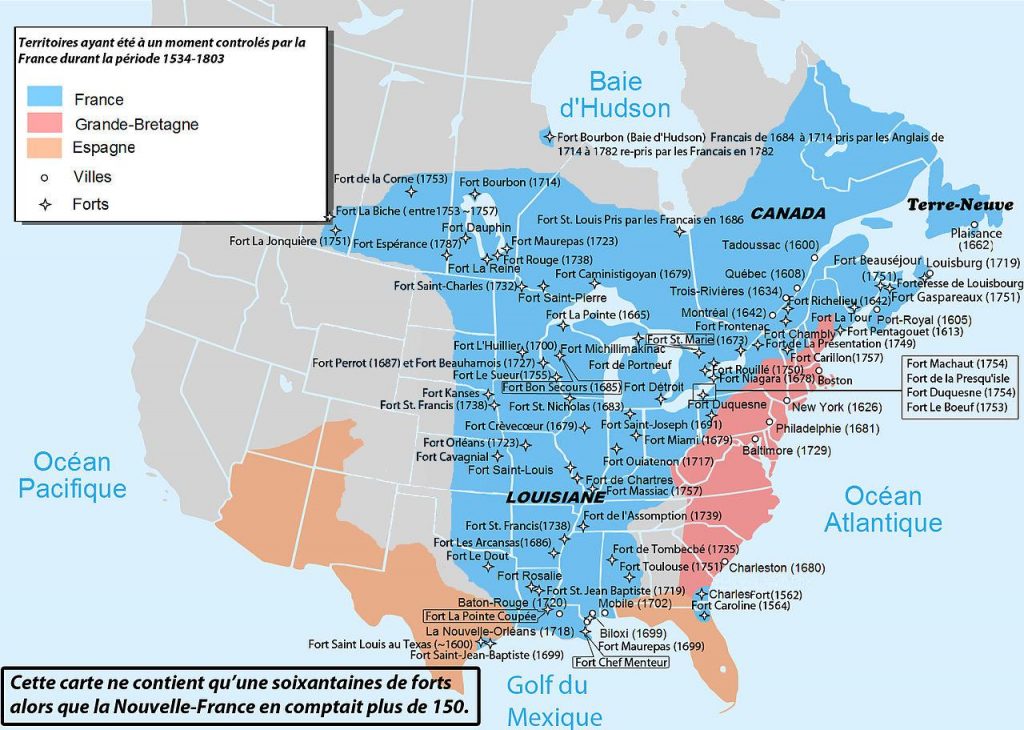______________________________________
Il en faudra des milliers et des milliers de petites paires de souliers pour nous remettre devant les yeux le drame émotionnel qu’ont eu à vivre et à survivre plus de 150 000 enfants issus des nations autochtones surtout du Canada et un peu moins du Québec. L’on se surprend tout à coup de découvrir ces fameux lieux de sépultures non marqués dont un registre a été exigé dans le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation (2008-2015) afin de faire en sorte que « ces âmes d’enfants puissent un jour retourner à la maison« .
Kamloops (C.B.), Marieval (Sask.), Cranbrook (C.B.), ce n’est que le début d’un chapelet de lieux de sépultures d’enfants autochtones qui traversent le Canada du fin fond de notre Ouest mythique canadien avec notre frère Louis Riel jusqu’au Québec en passant, bien sûr, par l’Ontario.
Comme nous le savons tous, il existe plusieurs litiges et contentieux entre les Autochtones du Canada et du Québec et les descendants euro-canadiens et euro-québécois que nous sommes. Que l’on parle de cession de territoire, de gestion de ressources tel que la forêt, les mines et les pêches, d’autodétermination voire d’autogouvernance, il y a place à la discussion entre deux éventuels partenaires égaux afin de pouvoir aboutir le plus souvent possible à des ententes qui ont l’allure de la Paix des Braves voire même de Paix des Braves Plus. Mais lorsqu’il s’agit de maltraitance et de négligence envers des enfants, autochtones ou non autochtones, il y a lieu de rendre des comptes et de connaître la vérité.
Ici, l’on parle d’un programme de scolarisation essentiellement pensé et exécuté afin de mettre un terme à ce qu’on nomme à l’époque au Canada de 1867, le problème indien. Le Canada de 1867 et des années suivantes avec l’expansion vers l’Ouest commencera timidement à instaurer des pensionnats autochtones qui selon de John A. MacDonald permettront de contrer l’influence néfaste des parents autochtones sur leur progéniture. Ainsi, on fera de ses sauvages des Canadien pure laine.
La découverte récente d’un cimetière adjacent à un pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique a remis à l’actualité une réalité déjà connue au moins depuis le Rapport de la Commision royale d’enquête sur les peuples autochtones mieux connue sous le nom Erasmus-Dussault (1991-1996). Pour être plus précis, c’est en 1990 lors d’une entrevue accordée à un média québécois par Phil Fontaine alors chef Autochtone manitobain que nous avons appris qu’il avait été, personnellement, victime de sévices sexuels entres autres au pensionnat qu’il fréquentait.
Dans la foulée de la crise d’Oka de l’été 1990 et de tous les dossiers autochtones qui n’aboutissaient pas à la satisfaction des parties concernées et particulièrement les Autochtones, le gouvernement fédéral, fiduciaire selon la Constitution de 1867 de la qualité de vie des premiers habitants du territoire a eu la brillante idée de faire le tour de toute la question autochtone afin de peut-être finir par solutionner une fois pour toutes le problème indien comme on disait en ce temps-là.
À l’époque, la Commission royal sur les Peuples autochtones (1991-1996) avait réservé un chapitre entier à ces pensionnats autochtones.Le rapport Érasmus-Dussault (1996) a mis la table pour la mise sur pied de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens du 8 mai 2006. C’est cette Convention qui a ordonné par son Annexe N, la création de la Commission Vérité et Réconciliation (2008-2015). Il importe de rappeler que cette Convention mettait fin aux différents recours collectifs entrepris par des groupes de victimes envers les différentes autorités civiles et religieuses dont les diocèses impliqués, les dénominations religieuses chrétiennes et les communautés religieuses. Ainsi, il est bon de souligner que le montant des compensations avancé lors des recours collectifs se situait autour de 1,4 milliards $. La Convention signée aboutissait à un montant de l’ordre de 175 millions de dolllars ! Ce fut toute une économie pour tout le monde.
La Commission Vérité et Réconciliation basée sur des modèles déjà connus de par le monde (Afrique du sud, Chili) n’est pas une commission d’enquête publique avec tous les outils juridiques normalement dévolus. Elle s’inscrit plutôt dans une démarche de justice transitionnelle connue aussi sous l’appellation de justice réparatrice. La CVR procède d’un processus de guérison par la prise de parole par ceux et celles qui ont subies des sévices et de la nécessité d’un « débreffage ». Dans la mesure où la commission a surtout voulu servir d’exutoire libérateur, elle a privilégié la prise de parole des autochtones blessés et fait peu de place à ceux qui avaient commis des méfaits ou avaitent tout simplement travaillés dans ces résidences. Ainsi, cette commission Vérité et Réconciliation n’ayant aucun pouvoir d’enquête n’est pas habilitée à procéder à des assignations. C’était le prix à payer afin de permettre la tenue d’une telle commission.
Ainsi, la CVR canadienne a pour but de colliger et d’archiver les expériences vécues dans les pensionnats par ceux et celles qui ont la capacité d’une prise de parole publique libératrice afin d’entamer un vrai processus de guérison. Plus de 6000 survivants ont ainsi pris la parole lors des différentes activités tenues à travers le Canada entre 2010 et 2015. D’ailleurs, Vérité, Guérison et Réconciliation sont trois termes d’une même équation et l’un ne va pas sans l’autre. Sinon l’absence de l’un invalide l’autre mais aussi fausse toute la démarche. Il faut avoir en mémoire le fait que les nations autochtones ont toujours privilégié la prise de parole. Ce sont des peuples de l’oralité connus aussi pour leurs légendaires palabres (Voir La Paix de 1701). Ainsi, le processus de la justice transitionnelle (réparatrice) repose sur quatre piliers: le droit de savoir; le droit à la justice; le droit à la réparation; le droit d’être protégé (la non répétition).
Bien que quelques pensionnats pouvaient exister avant la confédération de 1867, le prototype de pensionnats indiens dont il est question dans le rapport Erasmus-Dussault et de la CRV se situent entre 1880 et 1996. Au Québec, le réseau de pensionnats autochtones s’est établie beaucoup plus tardivement soit à partir des années 1930 et fut sous la gouverne de la communauté religieuse des Oblats de Marie-Immaculée (catholique). Rappelons qu’il nous faut distinguer entre ce qui s’est vécu du côté du Canada anglais et par conséquent du côté des minorités francophones de l’Ouest canadien et ce qui s’est vécu au Québec alors que nous n’avions qu’à peine six pensionnats sur les 139 répertoriés. Mais attention, distinguer n’est pas vouloir farder.
Comme nous le disions au début de notre article, des timides débuts de pensionnats typiquement autochtones ont commencé à voir le jour autour de 1856 mais au Canada anglais et dans les communautés francophones de l’Ouest l’envol a commencé autour des annnées 1880. Ce n’est que suite à une modification de la Loi sur les Indiens en 1920 que la fréquentation devient obligatoire pour tout enfant autochtone agé de 7 à 15 ans, quoi que l’on constatera assez vite (à partir de photographies de l’époque) qu’on y retrouve des enfants en très bas âge (3 ou 4 an). C’est ainsi que les enfants autochtones « tombent » alors sous la tutelle du gouvernement canadien qui mise désormais sur l’isolation et l’assimilation de force afin de régler une fois pour toute ce qu’on appelle à l’époque, le « problème indien ».
Mandatées par le gouvernement canadien, différentes dénominations religieuses ont fait oeuvre de sous-traitants puisqu’elles contrôlaient déjà tout le secteur de l’intruction publique et de l’éducation. Côté catholique, quelques diocèses et quelques communautés religieuses sont impliquées. Côté protestant, l’Église anglicane, l’Église méthodiste et la majeure partie de l’Église presbytérienne qui toute deux fusionneront pour devenir l’Église Unie du Canada.
Au plan typiquement missionnaire, l’on fait face à un renversement de la démarche pastorale des communautés missionnaires. Alors qu’auparavant, les missionnaires de l’Évangile allaient vivre en milieu amérindien désormais afin de stabiliser l’autochtone et le sédentariser, on obligera quelques générations d’enfants autochtones à vivre dans des établissements résidentiels.
Bien qu’un certain nombre de parents amérindiens ont pu accepter le projet de pensionnat pour leur enfant afin de leur permettre d’être outillé pour vivre dans ce monde moderne et industrialisé de la fin du XIXè et du début du XXè, ils n’en connaissaient pas tous les tenants et aboutissants.
Au fur et à mesure du développement du réseau de pensionnats autochtones, ceux-ci deviennent des ghettos d’enfants autochtones arrachés à leur famille et ainsi à leur culture ancestrale. Le projet éducatif de ces pensionnats a pour objectif de « Tuer l’indien dans l’enfant » quitte à tuer (par inadvertance) l’enfant indien lui-même soit par la contraction d’une maladie (tuberculose) ou par le suicide.
Vivre en pensionnat autochtone, c’est d’abord comme enfant d’être privé de l’affection de ses parents, c’est vivre l’abandon d’où nait le désespoir. Ajouter à cela le fait que le financement annuel per capita est dérisoire, que les communautés religieuses risquent des pénalités financières si elles n’atteignent pas un quota d’inscriptions, ce qui les conduit à une course au recrutement.
Conséquence première de ce sur-recrutement, des établissements surpeuplés. Une promiscuité qui amène son lot de maladies contagieuses particulièrement la tuberculose. Doublé d’un problème de malnutrition. Les restrictions budgétaires ne permettant pas à nourrir judicieusement les enfants auront aussi une incidence sur le plan disciplinaire. Ainsi, par souci d’économie ou par désir de contrôle pervers, un enfant malcommode ou difficile sera privé de nourriture en guise de punition. L’absence totale de surveillance et de contrôle par les autorités gouvernementales (Ministère des Affaires indiennes) sans oublier le fait que le modèle de pensionnat autochtone s’appuie sur la force de la coercition de l’État canadien (GRC), lui-même, favorisera la levée des différentes inhibitions de la part des adultes oeuvrant dans ce monde fermé sur lui-même (ghetto). Ainsi, on ne peut se surprendre, de l’accumulation de sévices physiques, psychologiques et sexuels. C’est le propre d’un monde clos comprenant des adultes et des enfants.
Si des enfants mouraient qui de malnutrition, qui de maladie socio-sanitaire d’autres mouraient tout bonnement de désespoir. On pense ici au suicide, aux fugues qui l’été pouvait se terminer en noyade et l’hiver par l’hypothermie alors que l’on retrouve un petit cadavre gelé sur la route ou dans la forêt. Sans oublier, les incendies, souvent allumés par les enfant eux-mêmes. Combien de petits cadavres calcinés retrouvés parce que les issues de secours étaient verroullées afin d’éviter les fugues !
Présentons sommairement, une radiographie et une infographie de l’état des lieux actuels. Autour de 150 000 enfants autochtones auraient fréquenté le réseau de pensionnats durant l’équivalent de plus d’un siècle. Quelques 4 000 décès confirmés. 32% de ces décès dont les noms ne sont pas enregistrés. 23% de ces décès où le sexe de l’enfant n’a pas été enregistré. Et, 49%, donc près de la moitié de ces décès dont la cause n’a pas été enregistrée. Il existe des cimetières bien identifiés près des établissements mais aussi des lieux de sépultures non marqués. C’est ceux-là entre autres, que l’on commence à découvrir au grand sursaut d’indignation. Le registre sera difficile à compléter dans la mesure où une loi de 1935 permettait de détruire les dossiers d’élèves cinq ans après la fin de leur fréquentation.
Il importe de préciser que tout au long du XXè siècle à tout le moins, les différents problèmes que rencontraient les administrateurs de ces pensionnats indiens étaient connus. Mais cela était connu sous la rubrique de faits divers. Le ministère des Affaires indiennes, les services de santé, la GRC savaient très bien que les taux de mortalité dans les pensionnats étaient anormalement plus élevés que du côté de la population blanche. Qu’importe.
Il ne faut pas oublier qu’à l’époque un enfant même euro-européen était loin d’être sujet de droit. On le considérait comme malléable et corvéable. Il était sous l’autorité parentale particulièrement l’autorité paternel avec possibilité d’être corrigé même physiquement. Il faudra attendre 1959 pour l’avènement de la Déclaration des Droits de l’enfant (20 novembre 1959) suivie trente an plus tard de la Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989). Sans oublier pour ce qui concerne l’objet cet article, la Déclaration des Nations Unis sur les droits des peuples autochtones (13 septembre 2007).
Cela dit, qu’en est-il exactement de la situation qui a prévalu ou aurait prévalu au Québec? D’emblée, il y a lieu de préciser que sur les pensionnats autochtones l’historiographie reste lacunaire. L’ouvrage le plus récent de Henri Goulet publié en 2016 circonscrit son travail autour des quatre pensionnats du Québec sous la responsabilité des pères oblats de marie-immaculée (o.m.i) et s’appuie essentiellement sur les archives oblatiennes déjà accessibles.
Par souci de transparence intellectuelle, l’auteur de ces lignes reconnaît ne pas avoir pris le temps de lire le livre de Goulet de l’Université de Montréal mais néanmoins en m’appuyant quelque peu sur la lecture de quatre recensions portant sur Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec, je peux être en mesure d’en saisir l’approche et le contenu essentiel. En se concentrant sur les quatre pensionnats oblatiens, cela permet à l’auteur d’éviter d’aborder plus largement, les autochtones du Québec que l’on envoyait dans des pensionnats ontariens par exemple.
Ainsi sur les 139 pensionnats résidentiels au Canada, à peine 6 furent établis sur le territoire québécois dont quatre sous la responsabilité des oblats: Fort George (Baie James), 1930-1980; Sept-Îles 1952-1971; Saint-Marc-de-Figuery (Amos) 1955-1973; et Pointe-Bleue/Mashteuiatsh (Lac Saint-Jean) 1960-1973. Comme on le constate, l’installation de ces pensionnats est tardif au Québec. En effet, après la seconde guerre mondiale, le gouvernement fédéral fait relativement volte-face concernant les écoles résidentielle en favorisant plutôt l’intégration des enfants autochtones aux écoles régulières des blancs.
Ce sont les oblats eux-mêmes qui ici se sont opposés au projet fédéral. Par un certain lobbyisme soutenu, ils ont convaincu le gouvernement de la justesse de leur approche particulière auprès des autochtones. Les pères oblats considéraient que les élèves autochtones auraient été en position de vulnérabilité dans les écoles publiques régulières. Ils auraient été trop désorientés. Ils craignaient pour les enfants autochtones un trop grand choc culturel. Il leur fallait un milieu spécifique capable de tenir compte de leur « indianité » en quelque sorte.
En effet, si l’on se fie aux archives oblatiennes, l’approche pédagogique favorisait la langue et la culture autochtones afin que l’enfant autochtone soit le lien entre la famille et la société blanche. Mais jusqu’où et jusqu’à quand cette pédagogie fut respectée, il semble que l’idée de sortir l’indien de l’enfant l’aurait tout de même emporté au fil du temps. Ce qui nous ramène au dilemme entre le curriculum voulu, le curriculum enseigné et le curriculum caché.
En fait, mise à part la recherche universitaire québécoise qui nous permettrait d’établir une historiographie typiquement québécoise de l’histoire scolaire des autochtones au Québec, je plaiderais pour une commission publique dont le gouvernement québécois et les premières nations du Québec établiraient ensemble les modalités de fonctionnement.
Faire oeuvre historienne n’a rien à voir avec la morale. Tenter une écriture de l’histoire c’est tenter de décrire le plus objectivement possible ce qui s’est matériellement passé en essayant d’en expliquer les différentes motivations. L’écriture de notre histoire nationale c’est l’écriture du vainqueur. Le développement de nos rapports avec les Autochtones doit-il nous faire regretter les voyages de Cartier et de Champlain ? Allons-nous mettre en procès Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys ? Peut-on comparer le choc culturel du XVIIè siècle et le programme des pensionnats ?
L’historiographie récente nous a conduit à laisser de l’espace aux récits souvent différents des vaincus. Quoi de plus fécond au plan intellectuel de faire chevaucher les différentes perspectives d’un plus ou moins même récit. Le programme des pensionnats autochtones, n’est pas un incidents de parcours, il s’inscrit dans la ligne d’un rapport colonial c’est-à-dire d’un rapport de subordination où l’entité la plus forte soumet l’entité la plus faible. L’accusation et le répentir sincère ne mèneront à rien si d’emblée on ne remet pas en question le processus colonial qui nous a permis de spolier les autochtones de leur territoire, d’exiger l’abandon de leurs coutumes ancestrale et culturelles et surtout de leur avoir fait perdre leur autodétermination.
Nous sommes en mesure de mettre fin d’abord à un certain aveuglement et ensuite à travailler avec les dix nations autochtones québécoises reconnues afin d’établir des relations politiques égalitaires et mettre en place les mécanismes qui permettront d’aplanir les contentieux de nature territoriale et gouvernementale.
En somme, il est impérieux que les Québécois prennent acte de la situation des peuples autochtones en s’appuyant sur le rapport Erasmus-Dussault (1996) qui a fait le tour de toute la question autochtone contemporine et non du problème indien ainsi que du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation (2015) sans oublier le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics: écoute, réconciliation, et progrès mieux connue sous l’appellation de la Commission Viens (Gouvernement du Québec).
La table est mise qui osera venir s’asseoir pour envisager une mise à niveau égalitaire où le lien colonial se métarphosera en rapport interculturel et transculturel où l’un et l’autre apporte et reçoit, où l’un et l’autre accepte d’entendre et de regarder la perspective d’autrui, où l’un et l’autre accepte d’aboutir ensemble à une solution qui ne fait pas de perdants mais des gagnants-gagnants. Pour le christianisme de l’Amérique française et particulièrement pour l’Église catholique, il lui faudra accepter le fond ancestral des spiritualités autochtones qui viendront colorées ses rites et ses manières liturgiques parce que ce n’est pas nécessairement vrai que la grâce ne passe que par la culture euro-canadienne avec ses modes de pensée et ses façons de faire aussi belles qu’elles soient.
Nous avons écris avec la craie de l’Évangile, une page sombre de notre histoire nationale. Espérons qu’avec la poussière résiduelle de cette craie, nous puissions écrire quelque chose comme nous réconcilier c’est-à-dire se rencontrer l’un et l’autre en mode égalitaire avec nos qualités, nos défauts, nos caprices mais avec la volonté « d’occuper ensemble » ce vaste territoire.
________________________________________
BIBLIOGRAPHIE
Alfred, Taiaiake (2017), En finir avec le bon sauvage, Nouveaux Cahiers du socialisme, (18), 65-70.
Baum, Gregory (2018). Les églises canadiennes se repentent de leur identification avec le colonialisme. Théologiques, 22, (1), 101-109.
Bousquet, Marie-Pierre (2016), L’histoire scolaire des autochtones au Québec: Un chantier à défricher, Recherches amérindiennes au Québec, 46 (2-3), 117-123.
Capitaine, Breig (2015), La signification de la mission et des pensionnats indiens dans la revue Kerygma (1967-2004), Études d’histoire religieuse, 81 (1-2), 123-140.
Cassandre, Prieto (2021), La demande de pardon du pape une étape essentielle de processus de réconciliation entre les autochtones et les non-autochtones au Canada: étude ethnographique de douze acteurs de la réconciliation au Québec, Mémoire de maîtrise, Programme Études internationales, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal.
Courchesne, Guyanne (2010), Interprétation excessive ou crainte fondée: pourquoi le gouvernement canadien rejette la Déclaration des Nations Unis sur les droits des peuples autochtones. Revue générale de droit, 40 (1), 97-144.
Couture, Denise et Roussel, Jean-François (2015), Théologies chrétiennes de la réconciliation à l’heure de la Commssion de vérité et réconciliation du Canada, Théologiques, 23 (2), 7-30.
Dulong-Savignac, Josiane (2019). Les pensionnats autochtones canadiens, histoire, mémoire: montages et regards sur les images d’archives par une exposition participative. Mémoire. Montréal (Québec, Canada). Université du Québec à Montréal. Maîtrise en théâtre.
Jaccoud, Mylène (2016), La portée réparatrice et réconciliatrice de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Recherches amérindiennes au Québec, 46 (2-3), 155-163.
Laverdure, Paul. (2017). Compte-rendu de » Pensionnats autochtones: des corrections/Henri Goulet, Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec:le rôle déterminant des pères oblats, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2016, 215 pages « . Les Cahiers de lecture de l’Action nationale, 11 (3), 7-8
Laugrand, Frédéric (2017), L’impossible vérité sur l’histoire des pensionnats: traumatismes, victimisation et réconciliation prématurée. Anthropologie et Sociétés, 41(3), 329-340.
Rousseau, Audrey (2011), Mémoires et identités blessées en contexte postcolonial: la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Mémoire, UQÀM, Maîtrise en sociologie.
Roussel,Jean-François (2015). La Commission de Vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats autochtones: bilan et prospective. Théologiques, 23 (2), 31-58.
Shulze, David (2018). Compte-rendu sur « Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec. Le rôle déterminant des pères oblats », Henri Goulet. Presses de l’UdM. 2016. 222 pages, Recherches amérindiennes au Québec, 48 (3), 131-135.
Trudel, Pierre (2000), Histoire, neutralité et Autochtones: une longue histoire… Revue d’histoire de l’Amérique française, 53 (4), 528-540.