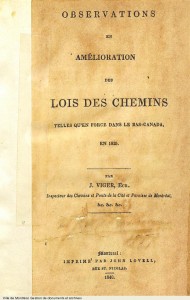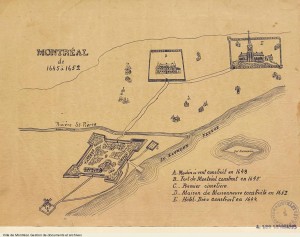(Portrait de Jeanne Le Ber. Source: Collection du Musée Saint-Gabriel)

(Peinture de soeur Jacqueline Poirier, recluse missionnaire, 1980)

( Détail d’une verrière. Basilique Notre-Dame de Montréal)

(Détail d’un parement brodé par Jeanne Le Ber. Source: Collection du Musée Saint-Gabriel)

(Parement d’autel dit de la Colombe du Saint-Esprit terminé vers 1700. Broderie préservée à la sacristie de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal)
________________________________________
Ce texte est une reprise revue, augmentée et améliorée voire corrigée de celui écrit lors de la célébration du troisième centenaire de la mort de Jeanne Le Ber (1714-2014)
Chaque fois que l’on parle de la fondation de Montréal, il est de mise de faire ressortir les figures historiques que sont Jeanne Mance (1606-1673) et Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve (1612-1676). Sans oublier, bien sûr, ceux et celles qui sont à l’initiative de cette folle entreprise, tel Jérôme Le Royer, sieur de La Dauversière (1597-1659). Comme dans toute entreprise humaine, il existe toujours des personnages hors du commun qui, de manière discrète, contribuent au succès d’un projet de grande envergure. Ces personnages de l’histoire peuvent être classés dans la catégorie d’illustres inconnus qui sont dans les faits des personnes méconnues de notre histoire. Jeanne Le Ber en est un bel exemple.
Jeanne Le Ber était la fille unique au sein d’une fratrie de cinq enfants (Louis, Jacques, Jean-Vincent, Pierre). Son père Jacques Le Ber (1633-1706) était un riche marchand de la Nouvelle-France et du Montréal naissant. Quant à sa mère Jeanne Le Moyne, elle est la soeur de Charles Lemoyne (1626-1685) dont le fils homonyme et cousin de Jeanne sera connu comme sieur de Longueuil et de Châteauguay. Jacques Le Ber était arrivé en Nouvelle-France avec son frère aîné François en 1657. Nous sommes donc dans la deuxième étape de l’établissement de Ville-Marie commencé en 1642. En 1660, les Le Ber et les Lemoyne décident d’un commun accord de construire une maison à deux logements distincts sur la rue Saint-Paul juste en face du bâtiment de l’Hôtel-Dieu de l’époque. C’est là que naîtra Jeanne Le Ber le 4 janvier 1662 qui aura comme parrain Maisonneuve dont le sort dans la colonie est en sursis et qui finalement quittera (désavoué) Ville-Marie en 1665 pour retourner définitivement en France.
Autant Jacques Le Ber était voué au commerce et aux affaires de la jeune colonie de Ville-Marie autant Jeanne a priorisé la vie intérieure et spirituelle. Bien que sa vie de recluse la tenait loin des tribulations de ce temps de fondation, elle s’en faisait toute proche par sa vie de prière et d’oblation comme on le verra plus loin. Mais tout en étant recluse, elle ne renonça jamais à la gestion avisée de son patrimoine familial qui lui permit de soutenir financièrement ses oeuvres matérielles, religieuses et caritatives.
L’on peut sans l’ombre d’un doute affirmer que se sont les femmes de son entourage immédiat qui ont semé en elle, le désir d’un accomplissement plus large et plus profond de sa vocation. Qu’il nous suffise d’évoquer sa tante Marie Le Ber (1644-1714) dite de L’Annonciation à ne pas confondre avec Marie de L’Incarnation, Jeanne Mance (1606-1673) qu’elle avait comme marraine et comme proche voisine et qu’elle fréquentait beaucoup dès sa tendre enfance et enfin Marguerite Bourgeoys (1620-1700). Juste à l’évocation de toutes ces femmes, on peut légitimement dire que la jeune colonie de Ville-Marie était entre bonnes mains.
Mais alors que le leg de notre histoire française et coloniale nous rappelle que Jeanne Mance fut la fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal, que Marguerite Bourgeoys fonda la Congrégation de Notre-Dame, qu’en est-il exactement de la contribution de Jeanne Le Ber? Pour les gens de son époque, mademoiselle Jeanne est non seulement la fille du riche marchand qu’est Jacques Le Ber mais elle est surtout la recluse de Ville-Marie.
Mais comment peut-on s’imaginer qu’une jeune fille dont la dot pouvait facilement se chiffrer à quelques 50 000 écus et qui était considérée comme l’un des meilleurs partis de la Nouvelle-France s’est « contentée » d’une vie de recluse? On peut risquer une réponse. Considérons simplement que sans rien enlever à la probité morale et à l’engagement religieux de Jacques Le Ber, sa fille Jeanne par sa vie de recluse fut en quelque sorte le pendant spirituel intérieur de la vie commerçante de son père. Bien que l’un ne dévalorise pas l’autre. D’ailleurs, l’aisance financière dont bénéficiat Jeanne, est tributaire de la réussite professionnelle de son père .
Cela dit, que savons-nous de Jeanne Le Ber? Que savons-nous de cette laïque-recluse que l’on nomme l’Ange de Ville-Marie? Elle est née le 4 janvier 1662 dans la colonie de Ville-Marie et baptisée le même jour par le père Gabriel Souart, celui-là même qui maria ses parents quelques années auparavant. De sa tendre enfance l’on sait peu sinon presque rien. De 1674 à 1677, donc entre 12 et 15 ans, elle fut pensionnaire au couvent des Ursulines à Québec. Elle est en bonne compagnie familiale puisque sa tante Marie Le Ber y enseigne.
Profitons-en pour présenter le projet éducatif dont bénéficiaient les jeunes pensionnaires des Ursulines. Au plan intellectuel, grammaire, arithmétique, catéchisme (cela va de soi) histoire et littérature. Bien que l’on puisse supputer qu’ici l’on parle d’histoire sainte et de littérature édifiante pour la vie de l’esprit, on ne doit pas perdre de vue que l’on avait le souci d’engendrer des filles lettrées.
Le second versant de ce projet éducatif était l’initiation aux arts dit féminins que sont la couture, le tricot, la dentelle, la broderie, le dessin et la calligraphie. Outre, l’appellation d’arts dits féminins qui peut nous faire sourire aujourd’hui, il appert que cette exigence de dextérité manuelle était vraiment hors du commun. Va pour la couture et le tricot qui permettaient la confection de vêtements du quotidien. Mais avec la dentelle, la broderie et la calligraphie, l’on peut vraiment parler d’art et de travail d’artiste.
Revenons maintenant à Jeanne. Alors que les Ursulines de Québec auraient bien apprécié la garder en leur sein, Jeanne rentre à Ville-Marie. Elle est maintenant âgée de 15 ans. À son retour, deux événements majeurs permettrons à la jeune fille de donner plus de lisibilité à sa vocation.
D’abord, en 1679, Jeanne est vivement affectée par la mort d’une jeune religieuse de la Congrégation de Notre-Dame dont elle s’était liée d’amitié. Année même où sa grande amie de quatre ans sa benjamine, Marie-Catherine Charly (1666-1719), entre au noviciat de la CND (elle sera supérieure générale de 1708 jusqu’à sa mort). Puis, un non-événement révélateur de sa vocation particulière. Par l’intermédiaire de son père, elle refuse une demande en mariage de ce qui à l’époque venait d’un bon parti. Ce refus confirma chez elle, et peut-être chez son entourage, la conviction que sa vocation personnelle, que l’état de vie qu’elle privilégiait, n’était point de nature conjugale et maternelle.
À l’âge de 18 ans, elle prend conseil auprès de l’abbé François Séguenot (1645-1727), un jeune prêtre sulpicien qui devint son confesseur jusqu’à la fin de sa vie. Ajoutons qu’en termes de direction de vie spirituelle, elle fut soutenue par les abbés Dollier de Casson, le supérieur des Messieurs de Saint-Sulpice à qui l’on doit une première rédaction d’une histoire de Montréal, l’abbé Vachon de Belmont et l’abbé Séguenot.
Mais si tant est que Jeanne ne soit pas attirée par le mariage, elle ne sent pas non plus le désir de vivre en communauté religieuse. Assez étonnant pour l’époque d’autant plus qu’elle en avait même l’embarras du choix puisqu’en Nouvelle-France, elle pouvait se faire Ursuline, Hospitalière de Saint-Joseph ou devenir membre de la Congrégation de Notre-Dame de sa grande amie Marguerite Bourgeoys.
Mais de par son tempérament et son type de dévotion, elle voulut une vie de recluse, c’est-à-dire une vie de solitude et d’oraison centrée sur le Saint-Sacrement de l’Eucharistie, sa pierre d’aimant comme elle aimait dire. L’abbé Séguenot en consultation avec son supérieur Dollier de Casson et l’abbé Vachon de Belmont qui sera son premier biographe, sont convenus d’un essai de cinq ans (1680-1685) d’une vie de recluse dans la maison familiale de Jeanne. Dans les circonstances, l’abbé Séguenot s’est employé à dresser à Jeanne une règle de vie où prière, lecture et travail manuel alternent.
Le 24 juin 1685, elle prononça un voeu simple de réclusion et de chasteté perpétuelle. En dépit de cela, Jeanne reste une femme libre d’esprit car autant en 1682 donc avant la prononciation de ses voeux, elle ne se rendit pas auprès de sa mère mourante (allant seulement prier au pied du lit à l’annonce de sa mort) autant en 1691 quand son frère Jean-Vincent fut tué par les Iroquois, elle se rendit près du corps et prit part aux préparatifs des obsèques. Elle fit de même en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. Bien qu’elle épouse un style de vie qui la situe dans le sillage de la pauvreté évangélique, elle refusa, sous le conseil avisé de son directeur, d’aliéner ses biens et son patrimoine. Nous sommes loin ici d’un cas de contradiction. En effet, la situation matérielle de la jeune colonie exigeait une saine prudence au plan financier.
Puis après l’équivalent de quatorze années de vie dévote et de réclusion dans la demeure familiale (1680-1694), il est temps pour Jeanne de passer à autre chose et de franchir la grande étape qui correspondra au mieux à sa vie dévotionnelle et oblative. Le couvent de la soeur Bourgeoys ayant été la proie des flammes (1694), Jeanne s’engage à financer les travaux de reconstruction en échange de pouvoir habiter quelques trois petites pièces adjacentes à la chapelle d’où elle pourra à partir d’une petite lucarne (hagioscope) avoir une vue sur le tabernacle de la chapelle. La pièce du rez-de-chaussée lui servira de chapelle et de parloir avec fenêtre sur le tabernacle; le premier étage sera sa chambre à coucher et finalement, le grenier « hébergera », entre autres choses, le métier à tisser et le rouet de Jeanne.
Le 5 août 1695, la chapelle est prête pour accueillir Jeanne. Elle a maintenant 34 ans. Après la célébration des Vêpres, un cortège se met en branle pour se rendre à la maison familiale y cueillir Jeanne afin de l’escorter jusqu’à l’église où elle prendra « possession » de ses appartements qui lui feront office de réclusoir. C’est dans ce nouvel espace, qu’elle continuera à partager son temps entre la prière, la méditation, l’adoration, la messe et son travail manuel par lequel elle brodera des vêtements d’église, des linges d’autel et des vêtements pour les démunis. Sur sa porte, elle écrira C’est ici ma demeure pour les siècles des siècles. J’y demeurerai parce que je lay choisy.
À la faveur de la nuit, quand l’église est fermée et déserte, en toute discrétion, elle se rendait prier avec ferveur devant l’autel. C’est dans cette optique qu’elle institua la pratique de l’adoration diurne du Saint-Sacrement pour les religieuses de Marguerite Bourgeoys et qui deviendra plus tard une adoration perpétuelle (jour et nuit) pour la communauté religieuse dont elle est l’inspiratrice (les Recluses missionnaires).
Jeanne tombe malade vers la fin du mois septembre 1714 et meurt le 3 octobre de la même année soit le lendemain de la mort de sa tante Marie Le Ber, ursuline à Québec. Elle fut inhumée près de son père car ce dernier avait demandé d’être enterré dans l’église des soeurs afin d’être près de sa fille.
Jusqu’à présent, nous n’avons qu’effleuré la vie spirituelle de Jeanne, la recluse. Il serait de mise avant de terminer ce texte de nous y attarder un peu plus. Précisons tout de suite, que c’est vraiment à grands traits que nous allons esquisser ce sur quoi pouvait reposer la vie intérieure de Jeanne Le Ber.
Malheureusement, bien qu’étant lettrée, Jeanne Le Ber ne laisse aucun écrit qui nous permettrait de saisir précisément sa spiritualité. Par conséquent, nous devons nous rabattre sur deux éléments de sa vie nous permettant avec une certaine justesse d’inférer ce sur quoi reposait sa vie spirituelle.
Le premier élément concerne son désir d’être recluse et le deuxième a trait aux principaux personnages ecclésiastiques qui l’accompagnent dans son cheminement, en particulier, l’abbé Séguenot. On sait qu’elle avait lu dans les Écrits de Marie de l’Incarnation que celle-ci au moment de son veuvage retourna à la maison paternelle et y vécut en recluse dans une pièce de la maison. On sait que ce genre de vie de recluse en milieu familial est connu et documenté. Mais il y a plus, il semble que l’on peut rattacher ce vouloir-vivre comme recluse à l’institution médiévale des reclus et des recluses qui a perduré pendant plus ou moins un millénaire dans la vie de l’Église mais particulièrement du XIème au XVIIème siècle.
Le deuxième élément qui nous aide à saisir sa vie spirituelle concerne son entourage de conseillers en matière spirituelle. En effet, depuis 1657, les prêtres de la Société Saint-Sulpice sont arrivés à Ville-Marie pour pourvoir à la vie religieuse de la colonie. La spiritualité sous-jacente à ces prêtres s’inscrit dans le vaste mouvement de renouveau religieux et spirituel issu du Concile de Trente (1545-1563). Si le XVIème siècle avait été le Siècle d’or de l’Espagne catholique en matière de renouveau spirituel, le XVIIème fut selon l’expression de l’historien Henri Bremond le siècle de l’École française de spiritualité. Au coeur de cette École française, quatre grands noms Condren, Bérulle, Olier et Jean Eudes.
Ce sont surtout les écrits du cardinal Bérulle qui marquent les esprits de l’époque et qui vont faire école allant même jusqu’à parler d’École bérulienne plutôt que d’École française. De manière très synthétique et schématique disons que cette école de spiritualité met l’accent sur le mystère de l’Incarnation qui nous conduit inévitablement à la charité agissante. Jean-Jacques Olier, fondateur des prêtres de Saint-Sulpice s’inscrit dans ce mouvement de renouveau et ce sont ces mêmes prêtre qui sont dans l’entourage de Jeanne Le Ber. Donc, il y a tout lieu de penser que tout le programme des exercices d’oraison et de dévotion dont on a parlé plus haut auxquels se prêtait Jeanne était nourri de cette spiritualité.
Ainsi, la vie intérieure de Jeanne Le Ber se trouve en quelque sorte aux confluents de deux traditions ecclésiales. La première ayant trait au mode de vie des reclus et recluses au Moyen-Âge et la seconde s’inscrivant dans le courant dominant du renouveau spirituel de son époque à savoir la spiritualité bérulienne.
En guise de conclusion disons simplement que si Jeanne Le Ber ne nous a laissé aucun écrit particulier, ses mains au lieu de manier la plume ont préféré coudre et broder nous laissant plutôt quelques oeuvres matérielles de linges d’autel et de vêtements liturgique. Mais le plus important à mes yeux, c’est que Jeanne Le Ber est cette recluse de chez nous dont la vie depuis une soixantaine d’années inspire une communauté religieuse de recluses qui subsiste comme un chêne à Montréal où une vingtaine de moniales recluses perpétuent, à leur manière et avec les adaptations nécessaires, la vie et le souvenir de Jeanne Le Ber. C’est autant cette communauté religieuse contemplative que Jeanne Le Ber que nous saluons aujourd’hui par ce texte.
_____________________________________
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
DEROY-PINEAU, Françoise, Jeanne Le Ber. La recluse au Coeur des combats, Bellarmin, Bellarmin, 2000.
DION, Marie-Paule, «La recluse de Montréal, Jeanne Le Ber», Église et Théologie, 22,1991, p.39
SIMARD, Thérèse, Jeanne Le Ber. Un itinéraire, Novalis, Montréal, 2014.
TREMBLAY, Monique, « Jeanne Le Ber en marche vers la vénérabilité », Signes, Vol. 50, Juillet-Septembre 2015.
LIENS UTILES
http://reclusesmiss.org/wp/
http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/index.php